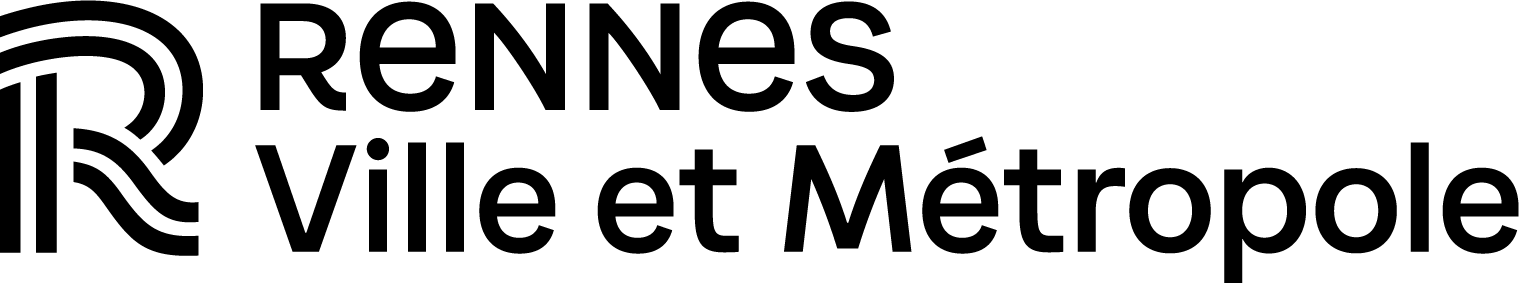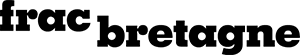Avant sa venue pour Revers, l’équipe des notes de comptoir a rencontré par visio Guillaume BRAC. Voici l’entretien complet :
Quel film vous a donné envie de faire du cinéma ?
Le film qui a été le plus déterminant pour moi a été Du côté d’Orouët de Jacques Rozier. En voyant ce film, j’ai eu l’impression que le cinéma pouvait être quelque chose de très proche de moi et de plus simple que ce que j’imaginais. Avec une caméra, une petite équipe, quelques personnages, un récit minimaliste, on pouvait tourner un film très touchant et très puissant, quelque chose de très humain, de très incarné, presque documentaire dans la manière de capter les moments de vie.
Je m’étais beaucoup identifié au personnage masculin principal (interprété par Bernard Menez). J’avais l’impression de vivre avec ce groupe de jeunes filles pendant deux heures et demie, de respirer le même air qu’eux. Je m’étais dit que c’est peut-être un type de cinéma que je pourrais envisager de faire.

– Hormis le titre L’île au trésor, il y a dans votre documentaire quelques références directes au roman de Robert Louis Stevenson : par exemple la carte de l’île de loisirs et le perroquet comme un des animaux indésirables. Toutefois, le spectateur peut s’interroger sur le lien profond avec le roman. Qu’avez-vous trouvé dans ce roman du XIXe siècle pour avoir donné son titre à votre documentaire ?
Le livre évoque un territoire fantasmé qui se trouve être une île. C’est aussi le cadre de cette base de loisirs, puisqu’elle est entourée d’eau. Je trouvais que c’était un très beau titre pour ce film.
J’avais lu le livre, enfant, dans une version abrégée. Je l’ai relu dans la version intégrale pendant le montage de L’Île au Trésor. J’y ai trouvé un parfum très fort d’enfance et de fantasme d’aventure. Cela résonnait beaucoup avec la matière qu’on était en train de monter. C’était une manière d’explorer un territoire à la fois réel, imaginaire, de découvrir ce territoire à hauteur d’enfant.
Sans oublier la notion de trésor. Je me suis aperçu que les gens qui fréquentaient cette base de loisirs cherchaient tous quelque chose, quelque chose de différent pour chacun.e. Chacun s’approprie en quelque sorte ce territoire. Il projette quelque chose de sa vie, de son imaginaire, de son passé. Cette dimension assez fantasmatique m’intéressait. Les lieux que je filme sont un peu transfigurés par l’imaginaire de chacun.
– Le spectateur retrouve déjà l’île de loisirs de Cergy-Pontoise dans votre moyen métrage de 2017, L’Amie du dimanche. Que représente pour vous ce lieu ?
C’est un lieu que j’ai découvert quand j’étais enfant, et qui m’avait à l’époque assez fasciné. Je ne l’ai pas du tout expérimenté de la même manière que les jeunes qu’on voit dans le film. Quand j’étais petit, je n’y suis jamais allé seul. C’était toujours avec mes parents. J’habitais assez loin. C’était une expédition familiale. En plus, j’avais la chance de partir en vacances, contrairement à beaucoup de jeunes qu’on voit dans le film. J’y allais plutôt hors saison. Je ne m’y suis jamais baigné, par exemple. J’y faisais d’autres activités J’ai eu une enfance beaucoup plus facile et privilégiée sur le plan matériel, économique que les gamins qu’on voit dans le film. Sans non plus la même liberté de transgression, d’aventure.
Ce lieu, je l’ai redécouvert à l’âge adulte. Là, j’y ai vu complètement autre chose, une espèce de lieu utopique qui rassemblait des gens issus de mondes, de communautés, de cultures, de milieux très différents. C’est un lieu assez rare et assez précieux où tous ces gens vivaient les uns à côté des autres de manière assez harmonieuse. Il avait une dimension plus politique.
Il se trouve aussi que ça m’a renvoyé à ce film d’Eric Rohmer, L’ami de mon amie qui avait cette base de loisirs comme décor. Mon approche, c’est à la fois les souvenirs d’enfance et, adulte, ce lien très fort au cinéma, à un auteur qui comptait beaucoup pour moi.
Je l’ai filmé une 1ère fois dans un film de fiction Contes de juillet, un film en 2 parties avec de jeunes comédiens du Conservatoire. J’ai tournée la 1ère partie L’amie du dimanche là-bas. C’était une manière de m’approprier le lieu avec la caméra, avec le cinéma. C’était presque dans une optique de repérage. J’avais ce projet de documentaire qui était vraiment le projet qui comptait.
– Dans L’île au Trésor, parfois, l’image montre autre chose que ce qu’on entend. Alors, pourquoi ce choix ?
J’imagine que vous pensez principalement à l’utilisation de la voix, de ces récits qui viennent comme ça, qui émergent presque de l’île. Ce que je trouvais fascinant, c’est que j’avais l’impression que c’était un endroit qui contenait une infinité d’histoires, de récits. Là, on a accès à quelques-uns dans le film, mais il y en aurait des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Ces bribes d’histoires semblent émaner de ce territoire.
Il y a 2 moments très brefs où les gens parlent face caméra, mais ce qui m’intéressait c’était de créer des associations, des résonances. Par exemple, le récit de la famille Afghane, ça a été vraiment fait en 2 temps. Une 1ère fois, j’avais filmé cette famille comme un peu des tableaux d’été, une sorte de bonheur comme ça, une partie de campagne. J’avais senti que, en les entendant parler entre eux, il y avait un sacré parcours de vie qui les avait amenés jusqu’à vivre ce moment-là, le dimanche où je les avais rencontrés. Je me disais que ce serait vraiment beau de faire résonner ces images-là du présent avec l’histoire qui avait précédé.
Filmer du bonheur et, en même temps, raconter quelque chose qui, heureusement, s’est bien fini, mais qui aurait pu être vraiment tragique. Je trouve passionnant, ce travail de montage entre les voix, les histoires et les plans. Avec ma monteuse, on ne cherchait pas à illustrer ce qu’on entendait, mais au contraire, plutôt à faire émerger une émotion nouvelle.
Il y a quelque chose du rapport au temps. Le film parle de la dimension éphémère de ces instants-là. On vit ces instants très précieux et presqu’au même moment, ils deviennent des souvenirs. Ça devient du passé.
–Ça veut dire que le tournage a évolué, aussi, à partir de ce que vous aviez initialement prévu ?
Oui, bien sûr. C’est un film qui est très, très peu écrit.
Quelques jours avant le tournage, j’avais écrit un texte pour moi-même et aussi pour les 3 personnes qui étaient avec moi, le chef opérateur, l’ingénieur du son et l’assistant mise en scène, pour qu’ils comprennent un peu ce qu’on allait filmer et capter pendant ces 2 mois de tournage. Je me suis rendu compte qu’en fin de compte, ce que j’avais écrit dans ce texte était assez proche de ce qu’est devenu le film.
En revanche, pendant le tournage, on tâtonnait. Le film s’écrivait au jour le jour, au gré des rencontres. Moi, je doutais beaucoup. J’ai passé quasiment la moitié du tournage à me demander si tout ça allait faire un film. Si tout ça allait former un tout cohérent, ou s’il n’y aurait que des lambeaux de réalité qu’on n’arriverait jamais à relier ensemble. C’était un film très risqué.
Au montage, il y a eu un très gros travail pour essayer de tirer des fils. Finalement, le film est assez tenu. Il est assez construit, même s’il peut donner l’impression d’une déambulation assez libre. Il y a quand même toute une architecture dans le film. Mais tout ça s’est trouvé au fur et à mesure. Les fondations n’existaient pas avant le tournage.
– Sur 2 scènes, le montage est assez particulier et va en l’encontre de tout le film. C’est le moment où il y a des jeunes qui plongent du pont et après il y a un cut, on est directement dans le bureau de la direction qui parle de la sécurité. Même chose lorsqu’on voit 2 jeunes qui escaladent un grillage. Pourquoi ce montage un peu brutal , même s’il provoque un effet de comédie ?
Ce qu’on aimait bien avec ma monteuse, c’était que ce directeur et son adjoint, en quelque sorte, sont vraiment les seuls personnages de tout le film qui sont en intérieur, qui sont dans une pièce fermée, dont on ne voit même pas les fenêtres. Ils semblent un peu coupés de la réalité, de ce qui se passe tout autour d’eux.
Ils sont un peu focalisés soit sur des questions sécuritaires, soit sur des questions organisationnelles, sur des histoires d’effectifs, de météo ou de règlements. Pour nous, c’était vraiment un contrepoint à la fois intéressant, mais aussi un peu ludique, d’où cette manière de tourner en dérision leur autorité.
Dans notre imaginaire, c’était une espèce d’immense cour de récréation, puis le proviseur et le proviseur adjoint qui sont là dans leur bureau, un petit peu hors-sol et qui ont l’impression de contrôler, mais qui ne contrôlent pas grand-chose.
– Ces personnes ont vu le documentaire ?
Oui, bien sûr. Le directeur était quand même assez bienveillant depuis le départ. Il a accepté tout de suite le principe de ce film. Il se trouve qu’il aime bien le cinéma, qu’il est assez cinéphile, même si la 1ère vision du film l’a un peu destabilisé. Parce qu’au-dessus de lui, il y a encore des gens plus importants. Il y a un président qu’on ne voit jamais. Il s’est demandé un peu ce que son président en penserait. La 1ère fois, il n’a vu que les transgressions. Il n’a vu que tout ce que le film montrait d’interdit. Il a vu le film beaucoup de fois. Il lui a fallu pas mal de visions pour vraiment l’apprécier et se détacher de son rôle de directeur. Au final, il était très fier et très heureux du film.
Leur présence posait de vraies questions. Par exemple, pour le loueur de Pédalo, Jérémy, c’était une vraie préoccupation pour moi de savoir si ce qu’on voyait et ce qu’on entendait de lui dans le film allait le desservir ou peut-être même risquer de lui faire perdre son emploi. C’était un risque dont lui avait pleinement conscience et qu’il assumait complètement. Il a pris ce film vraiment très à cœur. C’était son film à lui aussi, un film qui racontait son terrain de jeu depuis l’enfance. Et que ça en valait la chandelle. Il le dit d’ailleurs. Il va bien falloir que je parte. Maintenant, je suis plus un enfant. Il sentait qu’il avait fait un peu le tour de ce lieu aussi.
J’avais négocié avec le directeur une forme d’immunité pour lui. J’avais dit que je ne voulais pas que quoi que ce soit que vous verriez dans le film puisse être utilisé contre ses protagonistes. En lui disant que même si ce film est un documentaire, il y a quelque chose que je laisse volontairement dans le flou entre la part de réel et la part de fiction. Je lui disais que ce film, tout ça, c’est du cinéma. Il ne saura jamais si c’est complètement le réel ou s’il y a une part de mise en scène et de fiction là-dedans.
– Dans la bande-son, quelle a été votre approche sur la place de la musique dans ce documentaire ? Comment choisissez-vous la chanson du générique de fin de vos films ? Que représente pour vous Kingston Towndu groupe UB40 à la fin de L’île au trésor ?
J’’utilise assez peu de musique. Mais quand même, dans plusieurs de mes films, il y a une sorte de petit thème avec des variations, une petite ritournelle comme ça qui vient créer un pont, un pont émotionnel entre 2 séquences. Je sentais qu’il fallait de la musique, mais qu’il fallait que ce soit vraiment comme si l’émotion était retenue. Et qu’à un moment donné, cette petite ritournelle presque un peu enfantine allait libérer quelque chose. Dans ce film, la musique a une fonction de trait d’union. Elle fait le lien entre des personnages ou des âges de la vie différents et entre le jour et la nuit.
L’un des moments où, par exemple, ça me touche le plus, c’est la scène du parking. On voit le loueur de pédalo avec ses copains et ses copines partir dans le coffre de la voiture. Puis, on passe par un plan de nuit. Puis, on arrive sur le professeur à la retraite seul sur sa plage. Pour moi, la musique raconte vraiment quelque chose du passage du temps. Une journée qui se termine, la nuit, puis, on se réveille, on ouvre les yeux. En fait, on a pris 40 ans. Le temps a passé.
Il y a 2 thèmes. Il y a un thème mélancolique et un thème plus enlevé, un thème qui a plus à voir avec l’énergie de la jeunesse, de l’enfance. Et puis, un thème qui est peut-être plus sur le temps qui passe.
Je n’avais pas envie que la musique soit trop franco-française. J’avais l’intuition que de même qu’on voyait plein de nationalités, plein d’accents, plein de langues, il fallait que la musique vienne de très loin. En fait, je l’ai fait composer par un compositeur coréen qui a travaillé sur pas mal de films d’Hong Sang-Soo.
Ce qui est amusant, c’est qu’il a vu le film sans comprendre les dialogues. Il a travaillé uniquement sur la matière visuelle et sonore. Ce qui était assez beau, c’est qu’il a ressenti des émotions très fortes, alors même qu’il ne comprenait rien à ce qui se disait.
Quasiment tous mes films se terminent par une chanson. Et c’est comme si à chaque fois, il y avait une chanson qui contenait un peu la quintessence de ce que le film essaie de raconter. Cette chanson d’UB40 correspond vraiment à l’âge des jeunes protagonistes du film, il y a aussi quelque chose dans les paroles qui résonne discrètement. La chanson raconte la nostalgie d’un lieu perdu. Et puis, ça fait partie de ces chansons qui appartiennent un peu à tout le monde, à l’imaginaire collectif. Et d’une certaine façon, c’était une manière peut-être assez généreuse de finir le film aussi.

– Le générique de fin de l’île au trésor identifie les personnes que vous avez filmées à des personnages et semble leur attribuer des rôles. Est-ce que vous considérez que les personnes qui apparaissent dans votre documentaire restent des acteurs amateurs ?
C’est vrai que dans le processus de fabrication du film, il y a toute une part de jeu, dans certains cas même, de reconstitution. Des situations sont rejouées où finalement les protagonistes jouent avec la caméra, avec moi. c’est vrai que même si le film est sans aucun doute possible un documentaire, il y a une part dans la manière dont il est fabriqué de fiction, en tout cas de jeu.
On filme des personnes, mais à un moment donné, à la fin du travail de montage, on est en présence de personnages. Parce qu’ en quelque sorte, à partir de cette matière brute réelle qu’on sculpte, on garde certaines choses, on en enlève d’autres, on ne montre pas la personne dans toutes ses dimensions. Finalement, on crée un personnage à partir des personnes.
Il y a un travail de réécriture, en quelque sorte, des personnes et du réel. On part de personnes, mais ça devient des personnages.
– Il y a pas mal d’échanges qui sont autour des relations hommes-femmes. Est-ce que c’est quelque chose que vous avez cherché dans ce documentaire, ces relations un peu hommes-femmes, où c’est arrivé comme ça ?
Le film est beaucoup plus masculin que féminin En tout cas, j’ai filmé beaucoup plus d’hommes que de femmes. Par ailleurs, les quelques jeunes femmes qu’on y croise existent à travers le regard des hommes, et souvent d’ailleurs le désir des hommes.
J’ai beaucoup perçu l’île comme un lieu de jeu, d’aventure, et pas mal de drague aussi. C’est-à-dire un lieu dans lequel il y a une sorte de désir, de libido liée à la jeunesse, à l’été, au corps un peu dénudé. Je voulais aussi qu’il puisse y avoir, ce qui n’est finalement pas évident à filmer en documentaire, des scènes de drague ou de séduction. La plupart de ces scènes passent par le jeu et par des situations qui sont au départ un peu provoquées ou aidées par mon intervention.
Par exemple, sur la plage, quand les 2 garçons parlent aux 2 filles. C’était 2 garçons qui draguaient beaucoup de filles sur la plage. On avait repéré leur manège. J’avais aussi repéré ces 2 filles assez jolies qui étaient un peu à l’écart. Je suis allé les voir pour leur demander si elles seraient d’accord de participer à ce film, et pour le film, de se faire aborder par ces garçons. On a demandé aux garçons s’ils avaient envie d’aller draguer ces filles-là. Donc, c’était un peu comme une espèce d’expérience de chimie. C’était mettre ces 2 dragueurs avec ces 2 filles, et voir ce que ça donne.
Mais même à ce moment-là, on a fait 2 prises, parce que la 1ère prise, ils étaient excessivement timides et respectueux, mais trop. Ils n’étaient pas du tout eux-mêmes. La 2ème fois, ils étaient quand même plus proches de leur vérité.
Même s’il y a de la mélancolie, j’ai eu envie de faire un film sur la joie, sur le bonheur. C’est un film assez lumineux.
– Qu’il soit dans l’endurance et l’effort physique, en quête de l’autre et séducteur ou encore support de réflexion sociologique sur les comportements humains, vous filmez le corps sans filtre, sans chercher à le mettre en valeur. Qu’exprime-t-il pour vous, ce corps ?
A quelques exceptions près, le film montre plutôt des corps jeunes. Il y a une photogénie des corps dans le film. En revanche, il n’y a pas d’esthétisation du tout, parce que la manière avec laquelle on filme, c’est essentiellement des plans moyens et des plans larges. Ce qui m’intéresse, c’est avant tout d’inscrire les corps dans l’espace, dans le lieu, et de filmer les interactions éventuelles entre les différents corps. La caméra ne cherche pas particulièrement à s’approcher des corps, la caméra n’est pas dans un rapport sensuel au corps. Si les corps sont beaux, ils sont naturellement beaux, ce n’est pas la caméra qui va les sublimer.
Ça pose une question politique que je trouve intéressante. Ce qui est assez beau l’été, dans un lieu comme celui-là, c’est que les corps sont beaucoup dénudés, on voit beaucoup de gens en maillot de bain. Finalement, c’est comme si le costume social tombait, était laissé aux vestiaires. Ça crée au fond presque une forme d’égalité entre les uns et les autres.
– La dernière scène du film est celle avec les 2 enfants, où le plus grand encourage l’autre, le soutient, l’élève au sens éducatif du terme. Comment avez-vous fait cette scène, est-ce qu’elle a été écrite, suggérée, tournée ?
Ces 2 jeunes garçons habitent dans une petite maison très proche de l’île de loisirs. La 1ère fois qu’on les a rencontrés, ils semblaient seuls et livrés à eux-mêmes.
C’était une vision assez frappante de voir des enfants de cet âge-là, sans adultes. On a compris qu’il y avait leur grande sœur, qui était un peu plus loin, sur un banc. Elle était censée les surveiller… mis elle était sur son téléphone portable.

On les a filmés plusieurs fois, avec l’accord de leurs parents, ils sont revenus, il y avait toujours une sœur dans le coin, mais en fait ils étaient sous notre responsabilité. Pour la scène dont vous parlez à la fin, on les a suivis, c’était un moment après la rentrée des classes. L’idée était d’aller explorer un peu plus loin que la zone dans laquelle ils évoluaient d’habitude. A la fin, quand ils grimpent, c’est eux qui ont eu envie de grimper par là, parce qu’ils ne connaissaient pas cet endroit-là. C’est toutes les histoires qu’ils se racontent en arpentant ces zones un peu nouvelles pour eux.
– Est-ce que vous pourriez préciser votre démarche de cinéaste à propos du rapport documentaire et fiction, et à propos de l’approche du réel ?
Je me considère plutôt comme un cinéaste de fiction, mais on pourrait retourner les choses, parce que toutes les fictions que j’ai faites étaient très profondément nourries par les lieux et par les gens que je filmais. Par exemple, dans la dernière fiction que j’ai tourné, A l’abordage, tous les personnages du film sont très fortement inspirés et nourris par la vie, la personnalité des jeunes comédiens et comédiennes qui les interprètent.
On est sur des portraits sensibles. Pour arriver à capter ça, j’ai l’impression qu’il faut une part d’intervention et de mise en scène, donner un cadre un peu ludique aux gens qu’on filme, les impliquer dans l’acte même de mise en scène, les faire participer et ne pas juste les utiliser comme des objets filmés, les faire rentrer dans le jeu du film.
J’ai l’impression que c’est à cette condition-là qu’on dévoile des choses plus intimes, parce qu’il y a quelque chose de participatif et de généreux dans la fabrication.
J’ai une approche assez personnelle du documentaire. Je m’autorise certains outils de la fiction. . On pourrait aussi dire que mes documentaires sont un peu des fictions et que les fictions sont un peu des documentaires. Ce qui compte, c’est qu’au bout du processus, il y ait quelque chose d’honnête, de vrai et de juste sur les gens que je filme, que ces gens-là puissent se reconnaître.