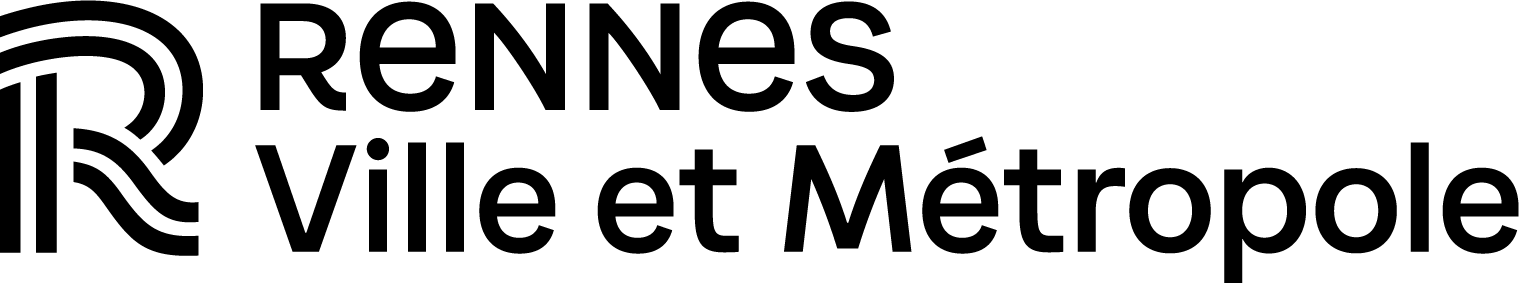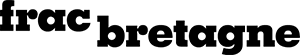Suite du dossier Revers, carte blanche à Maria Kourkouta, l’entretien complet avec la cinéaste.
Argentique/Numérique
Comptoir : Théo Angelopoulos, cinéaste que tu apprécies particulièrement a dit à propos du Regard d’Ulysse : « Chaque cinéaste se souvient de la première fois où il a regardé à travers l’œilleton de la caméra. Ce moment n’est pas tant la découverte du cinéma que la découverte du monde. »
Te souviens-tu de la 1ère fois où tu as regardé à l’œilleton de la caméra ?
Maria KOURKOUTA : Angelopoulos qui est un grand cinéaste identifie le cadre à sa conception du monde. Son œuvre le confirme. Je ne me souviens pas quand j’ai posé l’œil à l’œilleton, simplement aussi parce que c’est une autre époque. Au moment où Angelopoulos a commencé à faire du cinéma, mettre l’œil à l’œilleton de la caméra ne pouvait pas se faire par n’importe qui et n’importe quand. Aujourd’hui, on regarde le monde à travers des images tout le temps au point de ne plus s’en rendre compte.
En revanche, ce dont je me souviens, c’est quand j’ai vu et touché la pellicule pour la première fois. C’était en 2007, quand j’ai participé à un atelier de découverte du 16mm à l’ETNA, un atelier de cinéma autogéré par des cinéastes, à Paris. On apprenait comment développer dans le noir complet, à l’encontre du film photographique. Ces moments dans le noir et ce côté très tactile avec la pellicule ont été pour moi une révélation. J’ai senti la matérialité du cinéma. C’était magique.
C : Tu utilises la pellicule argentique, voire le double usage numérique/argentique. La matière de la pellicule semble importante ainsi que le noir et blanc parfois très saturé. Peux-tu nous en dire plus sur ces choix ?
MK : Personnellement, je ne suis pas dogmatique. Je ne m’impose pas de choix. L’important c’est de faire des beaux films. Ça veut dire des films qui peuvent toucher, où le réalisateur y met tout son monde et ce monde arrive au spectateur. Que cela se passe en pellicule ou en numérique, je n’ai pas de jugement là-dessus. Chacun décide comme on décide pour les cadrages.
Travailler en pellicule présente un coût différent pour la production d’un film. Le côté positif est que cette économie impose pas mal de contraintes qui font qu’on doit trouver des solutions inattendues. Finalement, on finit par chercher, fouiller encore mieux, pour transmettre. En grec ancien on dit : « la pauvreté invente les arts ». Personnellement, j’ai utilisé la pellicule quand j’ai senti qu’il y avait une nécessité par le film lui-même et non par un choix idéologique, même si j’ai longtemps été engagée dans des collectifs de cinéma qui travaillent avec la pellicule.
Le film Les spectres hantent l’Europe est un exemple idéal. Le tournage en numérique et en pellicule m’a permis d’aborder différemment ce qui était face à moi. C’est important de se poser la question : qu’est-ce que ça fait d’avoir entre les mains une caméra pellicule ou une caméra numérique ? Pour nous, réalisateurs, et pour les sujets filmés ?

Pour Retour à la rue d’Eole qui est un film de found footage, j’ai fait pas mal d’allers et retours. J’ai pris les vidéos sur You tube. Donc, s’il n’y avait pas le numérique, je n’aurai jamais pu manipuler ces images. Je les ai montées sur mon logiciel de montage vidéo Final Cut. Ça ne me suffisait pas. Ça me paraissait faux, pas vivant. J’ai alors fait un kinescopage, c’est-à-dire un transfert sur pellicule. Avec la pellicule, j’ai vu qu’il y a moyen de jouer avec les contrastes, ce que je ne pouvais pas faire avec le numérique, et plus globalement, de changer le rendu de l’image. Là, c’est devenu un film. Puis, il y a eu un retour sur le numérique pour pouvoir diffuser le film, même s’il existe également en 16mm. Donc, c’est un film techniquement très… contemporain ! Surtout, ces allers-retours convenaient avant tout au film lui-même, à son propos.
2 caméras – 2 films – 2 regards.
C : A la fin Des spectres…, j’ai eu l’impression que tu nous proposais un autre film. La transition vers des prises de vue en argentique dénote créant une rupture visuelle significative. Peux-tu nous expliquer quelle était ton intention derrière ce changement de médium ? Qu’as-tu voulu transmettre ?
MK : Une fois là-bas, à la frontière, j’ai filmé avec deux caméras : argentique et numérique. J’avais donc ces deux matières entre les mains quand j’ai commencé le montage. Je ne pouvais pas exclure l’un ou l’autre. Au début je voulais faire quelque chose avec les deux mélangés mais chacun était complètement différent.
Lors du tournage, quand j’ai essayé de tourner en pellicule ce que j’avais tourné en numérique et inversement, ça ne marchait pas. Par exemple, un jour j’ai tourné une bobine entière (c’est-à-dire presque 10 minutes), comme je faisais avec ma caméra numérique : en plan continu, sans coupe, avec caméra posée et fixe. Le plan était magnifique, mais, non, on aurait dit que c’était un film d’il y a 60 ans. L’image était coupée de son présent. En revanche, sur les images pellicule noir et blanc faites avec la caméra à l’épaule, là où on voit les gens et notamment leurs visages, l’effet est très différent. Il faut dire qu’avec la caméra numérique on avait très subtilement évité les visages. Certes, on l’a essayé mais on a constaté que ceci créait des rapports de pitié envers ces gens. Ils ont des visages magnifiques, fatigués mais très intenses et donc, tout de suite, une émotion se dégage de notre part. On voulait éviter cette émotion pour déplacer le centre d’intérêt. Filmer alors en numérique plutôt leurs corps sans trop de visages, à hauteur d’enfant et en cadrages collectifs, ou même leurs chaussures, ceci nous a paru plus juste par rapport à ce qu’on voulait susciter chez le spectateur et plus éthique vis-à-vis de ces gens.
Le film est donc très structuré finalement : d’abord la partie numérique, vers la fin la partie argentique. Au début, il y a les files d’attente. Le spectateur qui tient jusqu’au bout de l’attente va ensuite voir les échanges entre les migrants qui se révoltent. Le spectateur qui va écouter, entendre leurs paroles, va alors revenir au camp d’une manière plus humaine. C’est un peu comme une épreuve pour les spectateurs, un cheminement en étapes. Passer du numérique à la pellicule, c’est aussi une autre manière de passer d’un état à un autre état. Enfin, tout est comme notre propre expérience, notre propre vécu sur le camp : on n’envisage pas ces gens – et nous-mêmes par rapport à ces gens – au début du tournage de la même manière qu’à la fin de ceci. Nous espérons que la même chose arrive au spectateur au cours du film.

Utiliser ces deux médias et les mettre dans le montage final, c’est un clin d’œil sur ce qu’est le cinéma. Les deux parties – numérique et argentique – sont le même regard : le mien, puisque c’est moi qui regarde à travers les cadrages. Mais j’ai vite remarqué que, quand je tournais en numérique, j’étais invisible pour les migrants : pour eux j’étais comme tous les autres journalistes qui les entouraient et les filmaient. Ils s’en fichaient. Ils étaient surtout préoccupés par trouver de quoi manger et que leur situation soit le plus connue possible au reste du monde. Quelque part, ma caméra numérique « journalistique », posée, immobile, à cadrer leurs pieds, c’était un dialogue avec cette indifférence. Car, moi, je les accompagnais dans cette attente. De l’autre côté, quand j’avais la caméra pellicule sur l’épaule, il y avait au moins vingt enfants qui couraient derrière moi, et il y avait des gens qui m’arrêtaient en me disant « Ah, mon grand-père, avait la même caméra… » ou « C’est du cinéma !» ; ce qui changeait complètement les rapports entre eux et moi, grâce à la caméra. Ça se voit dans les plans tournés en pellicule : ils sourient, ils me saluent joyeusement, ou bien ils posent comme si on prenait une photo de famille. C’était très chargé émotionnellement pour moi qui cadrais. C’est comme un commentaire sur le cinéma, le rapport qu’il crée entre nous et le monde.
Mais tout ça, de manière instinctive. Je n’allais pas là-bas avec une idée de tournage. J’allais et je me laissais porter par ces rencontres à travers les deux caméras. Et c’est finalement comme deux faces de la même réalité.
Enfin, le poème de Niki nous a permis de prendre une position encore d’une autre manière, verbale. Voilà la structure du film : le silence, puis les paroles des gens entre eux, le silence, puis notre parole. C’est un choix. C’est ça le film.
La musique en images
C : David Lynch définit son premier court-métrage comme de la peinture en mouvement. Est-ce que toi, qui voulais devenir musicienne, définirais-tu tes travaux comme de la musique en images ?
MK : Je joue de la musique comme amatrice, mais surtout j’ai toujours été profondément portée par la musique. Les personnes qui m’ont le plus influencée sont des musiciens comme Mános Hadjidákis ou Lena Platonos – qui lit d’ailleurs le texte de Niki dans notre film Les spectres. Je l’écoute depuis mon enfance. Ce sont des personnes qui m’ont influencée entre autres pour mon sens du montage.
Souvent, avant de monter, j’ai une musique dans la tête. Le film le plus « musical » que j’ai fait, c’est celui que j’ai monté avec Claire Atherton, Intermède, parce qu’il n’y a aucune musique dedans. Mais le montage des images et la création sonore qui en a suivi étaient faits de manière très musicale, pas au sens mélodique du terme ; au sens d’une grande attention au rythme créé par les images et les sons, au temps qui coule. Andrei Tarkovski disait que le rythme n’était pas la juxtaposition de plans ou la dynamique du montage à la Eisenstein. C’est la sensation profonde du temps. C’est peut-être une autre forme de musicalité, moins métrique et plus du côté de la sensation.
Le rapport donc à la musique est dans ce travail sur les durées, mais aussi sur les motifs : les boucles, les répétitions… Je m’aperçois d’ailleurs que j’utilise souvent des termes musicaux pour les titres de mes films : Intermède, Prélude…

C : Dans Les Spectres…, tu avais demandé à l’ingénieur du son de ne pas forcément enregistrer ce que vous filmiez. Il se promenait dans le camp et enregistrait l’ambiance sonore et ensuite, au mixage, vous avez séparé ce qu’on voit et ce qu’on entend.
MK : Sur la caméra numérique, j’avais un micro donc du son direct. J’ai ensuite rajouté d’autres couches de sons. On avait cette liberté car les images étaient abstraites. On pouvait facilement mettre des sons pris à d’autres moments, mais dans les mêmes lieux. On a aussi parfois remplacé le son direct par des bruitages, lorsque c’étaient des gros plans, comme sur les chaussures. Plus rarement, il y a eu une reconstruction sonore totale, comme au premier – et plus long – plan du film.
C : C’est également le cas dans Intermède.
MK : Dans Intermède, il n’y a aucun son direct. L’ingénieur du son, André Fèvre, qui a été quelques fois avec moi au tournage, prenait des ambiances et plus rarement des sons précis. On était chacun dans son monde. J’ai confiance en lui et je sais que plus tard on va faire rencontrer nos deux matières. C’est aussi un extraordinaire bruiteur capable de trouver des solutions après coup. Une petite anecdote au moment du montage son. On n’arrivait pas à trouver un son pour l’arrimage d’un bateau. Chez lui, la machine à laver tournait, il a donc pensé à mettre un micro-contact sur la machine parce qu’il y avait tout ce dont on avait besoin : le mouvement, l’eau, la pression. Résultat : dans un petit studio sur la place Nation, on a fait l’arrimage d’un bateau de Thessalonique ! Quelqu’un pourrait dire « c’est faux », « ce n’est pas du documentaire », « ce n’est pas la réalité » mais je ne cherche pas la réalité, je cherche la vérité, transmettre la sensation d’une expérience… J’adore les solutions comme ça.
Des images, de la musique, des poèmes…
C : Dans Retour à la rue d’Eole, il y a 3 éléments : les images retrouvées, les poèmes et la musique. Comment s’est fait le film ?
MK : Tout a commencé par les images. J’étais obstinée à faire des boucles sur mon ordinateur. À l’époque, j’étais plutôt du côté de la théorie. Je ne « jouais » pas avec cette matière en vue de faire un film. C’était une manière d’être en contact avec mon pays, pas la Grèce au sens du territoire, mais la Grèce au sens émotionnel des origines. Petit à petit, j’ai ajouté les musiques de Manos Hadjidákis – souvent des retranscriptions de rembétiko – et j’ai tenté de synchroniser des choses. Les poèmes sont venus plus tard. Ce sont des poèmes que je partageais beaucoup avec mes amies. C’est comme les montages audios que l’on faisait sur les cassettes audio quand nous étions adolescents.
Dans une projection de films expérimentaux organisée par Light Cone, j’avais vu un film de found-footage : Lyrisch Nitraat de Peter Delpeut, où le cinéaste mélange des films d’époques différentes. Du coup, je me suis dit que je pouvais essayer de mélanger toutes ces séquences que je montais séparément jusqu’à là, pour fabriquer un seul film. À la fin, avec les poèmes, j’ai créé une sorte de continuité narrative de manière très libre.
C : Le rythme, la cadence, le mouvement insufflé par les personnages qui courent ou encore qui répètent les mêmes gestes, tout cela est très présent dans tes films. Il y a un aspect pictural mais aussi du rythme, une cadence. Peux-Tu nous dire ce que cela raconte du temps?
MK : De manière générale, ce que j’aime le plus au cinéma, ce sont les films qui laissent le temps couler. Au début, j’ai aimé le cinéma parce que j’ai vu les films de Théo Angelopoulos qui a beaucoup travaillé avec les plans-séquences. Depuis j’aime tous les films où l’on traite du temps comme une matière, une matière « à sculpter » comme disait Tarkovski. C’est la même chose pour les films de Chantal Akerman, Michael Snow, Béla Tarr, Gus Vant Sant, le cinéma japonais… D’ailleurs, les théories des cinéastes sont souvent des théories sur le temps, son organisation (si on pense aux cinéastes qui aiment le montage) ou bien son écoulement (si on pense aux cinéastes qui aiment les plans prolongés). Et ça fait parfois le style de chacun et chacune.
Concernant mes films : dans Préludes, j’ai pris des photos et je les ai mises en mouvement avec un jeu sur l’illusion du mouvement. Je voulais comprendre d’où vient le cinéma, comment on fait du mouvement en juxtaposant 24 images par seconde. Ces petits films m’ont aidé à expérimenter avec le temps ou plutôt sa décomposition. Bien plus tard, dans Les spectres…, j’ai expérimenté les longues durées. Bref, le temps m’intéresse beaucoup aussi au sens du temps historique : le passé, le passé des images, de mon vécu, de mon pays…
C : C’est une vision expérimentale du temps cinématographique.

C : Dans tes films, il y a un aspect très social. Tu as un rapport avec les classes populaires ou très pauvres. Comment ta classe sociale a pu te former dans ta vision du cinéma ? Comment racontes- tu cela ?
MK : Pour les gens que je filme comme, par exemple, les ouvriers du chantier naval, des prolétaires donc, le but n’était pas de réaliser un documentaire sur leur travail sans doute très dur. Ces ouvriers précisément appréciaient leur patron, ils avaient des rapports de grande camaraderie entre eux, d’amour et de fierté pour leur métier. J’ai donc plus été touchée par une sorte de tendresse que par la fatigue de leur quotidien. C’était la période de la crise économique en Grèce et dans ce moment de suspension, d’impasse et d’angoisse, à mes yeux ces gens, par leurs gestes quotidiens, faisaient tourner la terre chaque matin. Comment le dire, ils remettaient le sens au bon endroit, et ce petit chantier était comme un coin du monde – à la lisière du monde – qui portait une sagesse et un mouvement très justes et intemporels. C’est cette vision que j’ai voulu inscrire dans mon film.
Pour les migrants, qui sont, dirait-on, des sous-prolétaires… On n’a pas voulu les envisager avec pitié, on a beaucoup résisté à cette émotion qui crée trop vite des rapports de force. Oui, ils étaient pieds nus, ils avaient froid, ils étaient affamés, malades, et moi je rentrais le soir dans mon intérieur douillet. J’étais consciente de cette contradiction. Pourtant, vers la fin du tournage – et c’est ce que Niki a essayé de dire dans son poème – on a réalisé que leur désir de vivre et de transgresser toute sorte de frontière était plus fort que tout. Il était indestructible. Quelque part, ce n’était plus eux les « faibles », mais nous, qui vivons avec nos assurances et nos certitudes. Dans mes certitudes à moi, c’est ces tremblements de terre d’inversement des conditions qui m’intéressent.
C : C’est la meilleure réponse que je pouvais avoir.
Des plans fixes
C : Tu aimes les plans fixes où quelque chose ou quelqu’un entre d’un côté du cadre et ressort de l’autre comme ces madriers ou ces migrants. Technique qu’utilise aussi Chantal Akerman en particulier dans son film D’est. Akerman utilise le travelling que tu ne choisis pas.
MK : J’aime beaucoup ce que le hors champ peut apporter grâce à la fixité du cadre. Mais le filmage se fait assez instinctivement. J’ai l’impression que le mouvement de caméra rend la présence du cinéaste plus forte à l’image et c’est merveilleux quand c’est assumé. Par exemple, lorsque Chantal Akerman fait ses travellings magnifiques dans D’est, on sent que c’est elle qui regarde. Et grâce à son regard, elle nous transmet toute une ambiance d’une certaine époque de la Russie ; et par ses cadrages collectifs elle évoque peut-être la Shoah ou tant d’autres histoires. Ça ouvre à plusieurs champs. Dans mon film, cette fixité est en plus grande cohérence avec l’immobilité que ces gens vivent et l’absurdité du mouvement autour d’eux, à savoir que les trains n’ont pas cesser de traverser la frontière sous leurs yeux, jusqu’à leur soulèvement. J’ai voulu donc par la fixité me mettre un peu dans… leurs chaussures.
De manière générale, je cherche à faire de « jolis » cadres, des belles photos. Mais parfois je lutte contre ça car ce n’est pas la belle image qui restera à la fin. Par exemple, dans les rushes d’Intermède, j’avais quelques beaux plans qui n’ont pas trouvé de place au montage final. Claire Atherton qui a monté le film est particulièrement sensible à cette question de l’image juste, plutôt que belle. J’ai beaucoup appris d’elle. Parfois donc il faut lutter contre le côté trop esthétisant qui vient de notre amour pour les images et chercher plus du côté de la vérité. C’est difficile de trouver l’équilibre entre les deux et souvent cela m’empêche de terminer un film, j’avoue.

C : Dans Préludes, le dernier film de la série est un panoramique à 360° sur des photos. Il part et arrive sur une palissade. Ce plan donne un sentiment d’enfermement. Il y a même un oiseau figé, qui ne peut pas prendre son envol. La notion de mur, de frontière, de limite, l’impossibilité de partir est constante.
MK : Quand on fait sincèrement des choses, on sort quelque chose de très profond de nous-mêmes qui souvent nous échappe consciemment. Tes propos touchent à quelque chose de plus intime, pas forcément conscient de ma part.
Le panoramique vient du fait que dans cette série de films, je voulais imiter les premiers mécanismes du cinéma. Ce dernier Prélude imitait donc les panoramas où on faisait défiler devant les spectateurs un panneau et ça faisait une histoire. C’était une recherche parmi d’autres sur les mécanismes du pré-cinéma. Pourtant, il est vrai que ce ne sont pas seulement des expérimentations, il y a aussi de mon vécu dedans, mais je ne saurai pas dire plus.
Entretien réalisé à comptoir du doc le 6 février 2025 par Hélène NOEL, Jade MOUNIER, Adrien DUTERTRE, Nino BOULORD et Jean-Luc LEBRETON.